GIEC: Autre point de vue avant synthèse: Sylvestre HUET, le Monde
Depuis lundi matin, à Interlaken en Suisse, se tient la réunion plénière du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le GIEC doit y adopter son 6ème rapport de synthèse qui sera publié lundi 20 mars. Un rapport très attendu. Les rapports de synthèse du GIEC, parus en 1990, 1995, 2001, 2007 et 2014, ont scandé la diplomatie mondiale et les négociations de la mise en oeuvre de la Convention Climat de l’ONU de 1992.
Ce rapport de synthèse ne devrait guère surprendre puisque son équipe de rédaction ne peut s’écarter des rapports des trois groupes de travail du GIEC, publié en 2021 et 2022. Il représente un défi intellectuel redoutable, car si ces trois rapports affichent près de 10 000 pages au total, la synthèse doit être beaucoup plus courte. Sa force viendra d’un phénomène sans précédent dans l’histoire des relations entre les experts scientifiques et les pouvoirs politiques : ce texte sera très probablement, comme tous les rapports du GIEC depuis 1990, adopté à l’unanimité, même lors de l’approbation phrase par phrase des « résumés pour décideurs ».
Or, cette réunion plénière se tient en format ONU. Chaque pays, chaque gouvernement pour être précis, y dispose d’une voix. Et ce sont les gouvernements qui décident à quel vote cette voix est utilisée. Le texte du GIEC est rédigé par des experts qui s’en tiennent à l’analyse des publications scientifiques et écartent toute tentative de détourner leur travail de cette expertise. Il est donc aisé de prédire que, lors de cette réunion plénière, les scientifiques vont une fois de plus tenir la dragée haute aux diplomates et aux gouvernements.
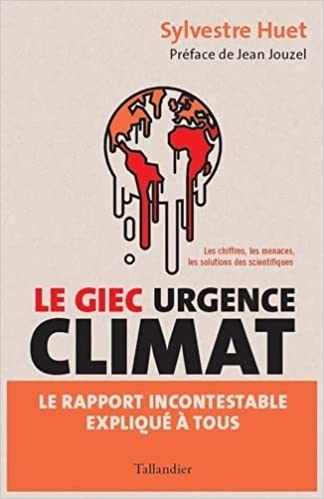
Comment en est-on arrivé là ? A ce rapport de force étrange pour des scientifiques plus habitués à devoir plier devant les pouvoirs politiques ? C’est Ce qui est expliqué dans ces quelques pages du livre Le GIEC, urgence climat, (en vente dans toutes les bonnes librairies) reproduites ci-dessous :
La proposition de créer le Giec est née lors de la réunion du G7 à Toronto (Canada) du 19 au 21 juin 1988. Elle est inscrite dans le texte final adopté par ce « sommet des pays riches » – États-Unis d’Amérique, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Canada, Italie – représentés par Ronald Reagan, Noboru Takeshita, Helmut Kohl, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Brian Mulroney et Ciriaco de Mita. Une telle alliance soumettant une proposition à l’Assemblée générale de l’ONU ne pouvait qu’obtenir satisfaction. Ce fut donc fait en novembre de la même année.
Quelles furent les motivations de ces chefs d’État et de gouvernement ? De Ronald Reagan, le héraut de la révolution conservatrice et du « moins d’État ». De Margaret Thatcher qui, des années plus tard, expliquait s’être fait berner par son conseiller scientifique John T. Houghton. De François Mitterrand, dont la fibre écologiste n’a jamais été évidente. Ils se sont retrouvés sur une idée : devant la mise en cause possible de la base énergétique de leur puissance, en particulier celle du pétrole pour les États-Unis d’Amérique, il était exclu que la conférence de Rio travaille à une Convention Climat sur la seule base des analyses du Programme des Nations unies pour l’environnement, soupçonné d’être sous la coupe d’écologistes peu favorables à l’industrie. Certains pouvaient y ajouter des intérêts immédiats, comme Margaret Thatcher engagée dans une lutte à mort contre le syndicat des mineurs de charbon. Condamner le charbon plus émetteur de CO2 que le gaz de la mer du Nord au kWh produit, au nom des intérêts supérieurs de l’humanité, ne pouvait que lui plaire.

Ces dirigeants ont donc plaidé pour une organisation hybride. Politique par son origine : il s’agit de répondre à une demande d’expertise exprimée par les gouvernements. Politique par son principe de fonctionnement : la nomination du bureau du Giec, des coprésidents de ses groupes de travail, et l’adoption phrase par phrase du « Résumé pour décideurs » de ses rapports, doivent suivre le mode onusien, par le vote d’une assemblée plénière où chaque pays dispose d’une voix. Mais scientifique par son mode de travail, puisque le bureau est chargé de recruter des spécialistes de chaque sujet traité pour établir une synthèse critique des productions scientifiques sur le changement climatique. Ainsi, pensent ces dirigeants politiques un peu naïvement, pourront-ils contrôler cette expertise dont le contenu pourrait bien être explosif pour le modèle de société qu’ils préfèrent et pour leurs puissances respectives.
Demande d’expertise
L’expertise demandée au Giec est ainsi présenté dans un texte officiel (1) finalisé en 1998 : « Le Giec a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. Les rapports du Giec doivent rendre compte des différentes orientations de façon impartiale, tout en traitant avec objectivité les facteurs scientifiques, techniques et socio-économiques sur lesquels reposent ces orientations. »
Il est possible de traduire cette formulation d’une manière plus claire quant aux craintes réelles des dirigeants politiques : la menace climatique est-elle assez forte pour justifier une politique drastique et volontaire de privation de l’usage massif des énergies fossiles, charbon, gaz et pétrole, donc l’essentiel de l’énergie utilisée pour la vie économique et quotidienne de nos sociétés ?

Cette demande d’expertise des gouvernements a bien identifié les dimensions économiques, sociales et politiques de la question posée. Mais ce n’est pas là une faiblesse qui affecterait le caractère scientifique du travail réalisé. C’est à l’inverse la condition d’une expertise correctement conduite, car organisée et menée en fonction de la question sociétale et non en fonction de la seule question scientifique qui serait « que sait-on ? ».
L’intervention des gouvernements sur le fonctionnement du Giec est précise et cadrée. Le texte officiel stipule : « Comme le Groupe d’experts est un organe intergouvernemental, les documents qui en émanent doivent être, d’une part, soumis à un contrôle scientifique par des pairs et, d’autre part, à un examen par les gouvernements. » La différence des termes n’est pas innocente. Les textes du Giec sont « soumis au contrôle scientifique » mais seulement « à un examen » par les gouvernements. Les rapports complets et les résumés techniques du Giec sont rédigés et adoptés par les seuls scientifiques. Tandis que les résumés pour décideurs sont certes adoptés phrase par phrase lors des assemblées plénières, mais, par définition, ils ne peuvent rien contenir qui ne soit déjà écrit dans les rapports complets.
Les raisons de la victoire
Dans ce mariage inédit entre science et politique, la première l’a emporté. De quoi faire se retourner dans leurs tombes Reagan et Thatcher, les deux chefs de file de la révolution fiscale en faveur des plus riches, lorsqu’ils entendent des manifestations juvéniles se réclamer du Giec pour mettre en accusation les systèmes économiques dominants et la responsabilité des pays riches ou des inégalités sociales dans la crise climatique.

Les raisons de la « victoire » de la science dans cet organisme hybride sont diverses. La principale provient de ce que le diagnostic quant aux causes, mécanismes et conséquences du réchauffement climatique est partagé par l’ensemble de la communauté scientifique mondiale. Il n’existe aucune équipe, aucun laboratoire à la compétence reconnue en climatologie, qui contesterait, avec des arguments acceptables par leurs pairs, l’analyse que le Giec fait de la production scientifique.
D’autres raisons ont contribué à cette victoire. Comme la diversité des intérêts géopolitiques face au changement climatique. Des pays producteurs de pétrole peuvent être tentés de minimiser la menace pour sauver leurs intérêts économiques. D’autres, non producteurs et très vulnérables aux risques climatiques, peuvent à l’inverse être tenté de les exagérer. Des pays très dépendants des importations d’énergies fossiles – comme presque tous ceux de l’Union européenne – ont intérêt à se tourner vers d’autres énergies et à justifier ce virage par la menace climatique. Les pays les plus pauvres peuvent s’appuyer sur leur faible responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre pour réclamer une aide des pays riches, responsables de la majorité des émissions, face aux menaces climatiques qu’ils auront intérêt à surestimer. Toutes ces tentations et tentatives de peser sur les travaux du Giec se sont annulées les unes les autres parce qu’elles se sont exercées dans des directions opposées. Il fut aisé pour les scientifiques de s’appuyer sur ces contradictions pour écarter ces pressions.
Le résultat fut et reste spectaculaire. Dans toute l’histoire du Giec, aucun gouvernement n’a osé donner mandat à sa délégation de voter contre les résumés pour décideurs. Cela peut sembler incroyable, étrange même. Mais ni les gouvernements d’Arabie Saoudite, ni ceux des climatosceptiques notoires comme les Bush aux États-Unis, n’ont osé le faire. Leurs pays, comme tous les autres, sont donc cosignataires de ces textes ! Difficile d’espérer une victoire plus totale pour les scientifiques.
Tempérer l’enthousiasme
Il faut toutefois tempérer l’enthousiasme qui pourrait saisir le lecteur à cette vision d’une science triomphant de la politique. Car cette victoire ne porte que sur le constat : le Giec conduit une analyse rigoureuse des causes et conséquences du changement climatique, ainsi que des moyens pour atténuer cette menace par la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. En revanche, il lui est interdit d’aller au-delà, c’est-à-dire de recommander une quelconque politique. De sorte que signer un rapport du Giec n’engage à rien en termes d’actions concrètes.
Ceci échappe souvent aux militants ou responsables politiques lorsqu’ils affirment : « le GIEC préconise » … ce qui suit étant souvent l’action qu’ils préfèrent. Le Giec ne peut rien recommander, cela lui est interdit par sa mission limitée aux informations « pertinentes pour la décision » et qui ne s’étend pas à des « prescriptions ». L’ironie de ce point crucial est que le seul rapport de toute l’histoire du Giec s’écartant de cette distinction est… le premier ! Publié en 1990, il contient de nombreuses « recommandations ». La plupart n’ont pas été suivies, comme celle d’un transfert de technologies vers les pays pauvres pour favoriser une croissance économique moins émettrice de carbone. Un seul exemple : ce rapport recommandait de revoir « les systèmes de prix et de barèmes douaniers afin de mieux tenir compte des coûts pour l’environnement ». L’exact contraire de ce qui a été fait depuis trente ans avec la diminution de toutes les barrières douanières au nom du libre-échange. La seule recommandation mise en œuvre ? Négocier une Convention sur le changement climatique dans le cadre de l’ONU.
Par la suite, les gouvernements et les scientifiques ont veillé à ce que cela ne se renouvelle pas et que la notion de recommandations ou de préconisations disparaisse des rapports. Cette limitation permet la réussite de la mission d’expertise, comme l’unanimité des votes des délégations gouvernementales lors de ses assemblées plénières. Elle suppose qu’un autre processus prenne le relais pour les décisions d’actions, soit dans chaque pays, soit dans le cadre des Conférences des parties (COP), les réunions devenues annuelles des pays signataires de la Convention climat de l’ONU.
Sylvestre Huet
